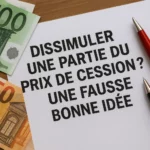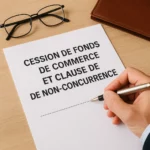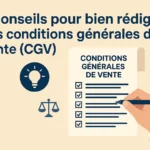La cession d’entreprise est une étape stratégique qui implique des enjeux financiers, fiscaux et juridiques considérables. Que ce soit pour une vente de fonds de commerce, une cession de titres de société ou une transmission partielle d’actif et de passif, les parties souhaitent souvent sécuriser l’accord de cession grâce à une clause de condition suspensive.
Ces dispositions permettent de subordonner la réalisation de la cession à l’accomplissement d’un événement futur et incertain. Sans cette garantie, l’acquéreur ou le cédant s’expose à des risques majeurs.
Dans cet article, nous allons voir qu’est-ce qu’une condition suspensive, quelles sont ses utilités, ses formes courantes, comment en vérifier la validité, ainsi que les enjeux juridiques et pratiques liés à sa mise en œuvre.
1. Qu’est-ce qu’une condition suspensive en matière de cession ?
En droit des contrats, une condition suspensive est une stipulation par laquelle les parties conviennent que l’acte de cession ne produira ses effets qu’à la réalisation de la condition prévue.
En d’autres termes, la conclusion de la vente dépendra d’un événement prévu à l’avance mais incertain. Tant que cette condition suspensive ne se réalise pas, le contrat de vente reste en attente.
Le Code civil prévoit que la condition suspensive doit être possible, licite et valable. Si elle est impossible ou illicite, ou encore purement discrétionnaire de la partie qui en bénéficie, elle sera réputée non écrite.
2. Pourquoi insérer une clause de condition suspensive ?
La rédaction de la condition vise à sécuriser le cadre de la cession.
Elle peut protéger l’acquéreur ou le cédant selon la nature du risque. Les avantages sont multiples :
- Sécurité juridique : éviter que la cession ne se réalise dans un contexte défavorable.
- Préservation des intérêts financiers : s’assurer que le prix de cession sera payé grâce à un financement bancaire ou une autre source validée.
- Protection contre les aléas : s’il survient un événement futur et incertain empêchant la réalisation de la cession, l’entreprise devient caduque sans pénalités.
- Souplesse dans la négociation : elle permet de conclure un compromis de vente tout en conservant une marge de manœuvre.
3. Les conditions suspensives les plus fréquentes
Dans la pratique, certaines conditions suspensives courantes reviennent souvent lors d’une cession d’entreprise :
- Obtention du financement : condition essentielle pour le futur acheteur, souvent liée à un financement bancaire ou à un apport extérieur.
- Approbation administrative ou réglementaire : notamment pour certaines activités soumises à autorisation.
- Absence de litige majeur : par exemple, si un procès en cours met en péril l’opération.
- Réalisation d’un audit comptable, fiscal ou juridique confirmant l’information transmise.
- Levée d’une clause résolutoire préexistante dans un contrat clé.
- Transfert des contrats stratégiques ou renouvellement d’un bail commercial.
- Accord des associés ou détenteurs de titres de société.
- Absence de préemption : par exemple lorsque l’on cède un fonds de commerce, la commune peut décider de le préempter.
4. Rédaction et validité de la condition suspensive
Pour être efficace, la clause de condition suspensive doit être soigneusement rédigée. Quelques points clés :
- Objet clair et précis : pour que la condition suspensive soit valable elle peut être déterminée ou indéterminée mais doit être suffisamment encadrée.
- Délai déterminé : un délai indéterminé peut fragiliser l’accord et allonger le délai de la transaction.
- Modalités de preuve : comment démontrer que la condition suspensive se réalise ou non.
- Neutralité : éviter qu’elle dépende de la volonté exclusive de l’une des parties (on parle de condition potestative).
Une clause mal rédigée ou trop vague peut être source de litige et compromettre l’exécution de la cession.
5. Que se passe-t-il si la condition ne se réalise pas ?
Si la condition suspensive ne se réalise pas dans le délai convenu, la conclusion de la cession est annulée de plein droit.
Le compromis de vente est alors réputé réalisé si, par exception, la partie protégée décide de renoncer à cette protection.
Lorsque la condition n’est pas remplie, l’acte de cession est considéré comme n’ayant jamais existé et le cédant reste propriétaire de l’entreprise.
Dans certains cas, une condition résolutoire peut également jouer, entraînant l’annulation après exécution de la cession. La condition résolutoire a un mécanisme contraire à celui de la condition suspensive : l’acheteur est propriétaire de l’entreprise mais, bien que la vente soit réalisée, peut être tenu de restituer l’entreprise ou le fonds si l’évènement intervient.
6. Conseils pratiques et erreurs à éviter
Pour éviter tout problème, il faut :
- Bien prévoir le cadre de la cession dès la négociation ainsi que la date pour réaliser la levée des conditions.
- Inclure toutes les conditions suspensives pertinentes.
- Vérifier la faisabilité de l’événement prévu.
- S’assurer que la partie qui en bénéficie a intérêt à l’invoquer.
- Ne pas oublier les critères liés à l’actif et au passif.
Par exemple, si vous indiquez, pour condition suspensive, que l’acquéreur obtienne une offre de prêt à un taux de 1%, la réalisation de la vente ne pourra dépendre que de sa bonne volonté. En effet, il est improbable qu’il obtienne une offre de crédit à un tel taux et cette clause reviendrait à lui offrir la possibilité de revenir sur son engagement d’acheter.
7. Rôle de l’avocat dans la négociation et la sécurisation de la clause
Un avocat en droit des contrats joue un rôle central dans la rédaction de la condition.
Il intervient à chaque étape d’une cession d’un fonds de commerce pour :
- Conseiller sur les conditions suspensives courantes adaptées au projet.
- Garantir la validité juridique.
- Sécuriser le processus de conclusion de la cession.
- Prévenir les risques de contentieux.
Pour lui permettre de bien rédiger l’avant contrat (promesse ou compromis), vous devrez lui indiquer quels sont vos besoins, les éléments relatifs à l’entreprise cédée ou acquise et toutes précisions sur votre situation personnelle.
8. FAQ
1. Qu’est-ce qu’une condition suspensive en cession d’entreprise ?
C’est une stipulation qui subordonne la réalisation de la cession à un événement futur et incertain.
2. Que se passe-t-il si elle ne se réalise pas ?
La conclusion de la vente devient nulle et l’entreprise devient caduque.
3. Peut-on renoncer à une condition suspensive ?
Oui, la partie qui en bénéficie peut y renoncer pour poursuivre la vente.
4. Quels exemples de conditions suspensives courantes ?
Obtention du financement, autorisations administratives, absence de litige, audit favorable, obtention d’un diplôme, absence de préemption de la mairie ou du bailleur etc.
5. Que se passe t’il si une clause est réputée non écrite ?
La question du caractère non écrit d’une clause est souvent portée à l’appréciation des tribunaux. Ce type de clause, contraire à une loi, est écartée sans que cela ne remette en cause la validité de l’acte. Par exemple, un bail commercial qui interdirait au preneur de céder le fonds de commerce, serait tout simplement écartée. Le locataire pourrait vendre son entreprise et le bail se poursuivrait … sans cette clause.
9. Conclusion
La condition suspensive est un outil essentiel pour sécuriser une cession d’entreprise.
Sa rédaction exige une attention particulière afin qu’elle soit valable, précise et adaptée au cadre de la cession.
En veillant à anticiper les risques et en s’entourant d’un avocat, les parties peuvent conclure un accord de cession solide, limitant les aléas et protégeant leurs intérêts.
Vous souhaitez céder ou acheter un fonds de commerce ?
📞 01 30 30 23 06 | 📧 cabinet@martin.avocat.fr
🗓️ Cabinets à Ermont et Pontoise – du lundi au vendredi
📍 Rendez-vous possible en visio ou en présentiel – Intervention dans toute la France