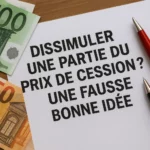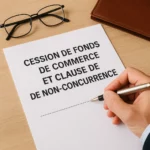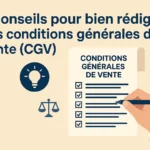Introduction
La cession d’un fonds de commerce est une opération complexe qui suppose une préparation juridique et financière minutieuse. Dans de nombreux cas, l’acquéreur ne dispose pas immédiatement de la totalité du prix de vente et doit recourir à un prêt bancaire. Pour sécuriser l’achat, il est donc fréquent d’insérer dans le compromis de vente ou dans la promesse synallagmatique de vente une condition suspensive de prêt.
Cette clause suspensive protège l’acheteur en lui permettant d’annuler la vente sans pénalités si le financement n’est pas obtenu dans le délai de validité prévu. À l’inverse, elle impose également des obligations, comme justifier de la demande de prêt et du refus de prêt auprès du vendeur.
Dans cet article, nous allons analyser en détail la condition suspensive de prêt, ses modalités, ses conséquences et les pièges à éviter lors de la rédaction d’un contrat de vente de fonds de commerce.
1. Définition et rôle de la condition suspensive
En droit français, la condition suspensive est un événement futur et incertain dont dépend la réalisation de la vente. Tant que cette condition n’est pas réalisée, l’acte de cession ou l’acte de vente n’a pas d’effet définitif.
L’article 1304 du code civil précise qu’une vente peut être conclue « sous condition suspensive », ce qui signifie que les parties acceptent de différer le transfert de propriété jusqu’à l’obtention de prêt : « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ».
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, cette clause est essentielle car elle protège l’acquéreur qui s’engage dans une transaction souvent lourde financièrement. Elle évite qu’il soit contraint de payer le prix sans avoir obtenu le financement nécessaire. En revanche, son but n’est pas d’offrir au bénéficiaire d’une promesse de vente le droit de se rétracter.
2. La clause suspensive de prêt dans la pratique
2.1. Mentions essentielles de la clause
La clause suspensive de prêt doit être rédigée avec précision afin d’être conforme à la jurisprudence de la cour de cassation (notamment les chambres civiles – pour les entreprises civiles et commerciales pour les cessions entre commerçants).
Elle doit notamment indiquer :
- Le montant maximal du prêt sollicité.
- La durée de remboursement envisagée (par exemple, les fonds de commerces sont financés sur 7 ans).
- Le taux maximal d’intérêt.
- Le nom de l’établissement bancaire ou la possibilité, voir nécessité, d’en solliciter plusieurs.
- Le délai prévu pour obtenir l’offre de prêt.
2.2. Délais et durée de validité
En général, le délai de validité de la condition suspensive est fixé entre 1 et 3 mois. Si l’acquéreur obtient son financement avant la date limite, la vente devient définitive par la réitération des volontés. En revanche, en cas de refus de prêt notifié par la banque, la promesse de vente est considérée comme caduque et la vente du fonds ne peut être réalisée.
3. Obligations de l’acquéreur et conséquences du refus de prêt
L’acquéreur doit démontrer sa bonne foi en justifiant avoir sollicité un financement conforme aux conditions prévues dans le contrat de vente. Cela suppose de :
- Fournir une demande de prêt auprès d’un ou plusieurs organismes financiers.
- Communiquer la réponse écrite de la banque en cas de refus de prêt.
- Respecter les délais fixés par la clause suspensive.
- Ne pas solliciter l’octroi d’un crédit d’un montant supérieur à ce qui est contractuellement déterminé par la promesse.
En cas de manquement, le vendeur pourrait invoquer la clause pénale ou réclamer une indemnité d’immobilisation, voire considérer que la condition suspensive de prêt est réputée réalisée.
Dans le cadre d’une promesse synallagmatique (ou compromis), qui engage les deux parties à acheter et vendre, il est possible de demander la réalisation de la cession en justice si l’un des deux se rétracte sans motif valable.
4. Conséquences pour le vendeur
Pour le cédant, la présence d’une condition suspensive implique une incertitude : tant que le prêt immobilier ou le prêt bancaire n’est pas accordé, la conclusion de la vente reste en suspens.
Cependant, cette clause est incontournable car elle permet d’attirer davantage d’acheteurs potentiels qui n’ont pas la trésorerie immédiate. De plus, elle constitue une garantie légale, prévue notamment par le code de la consommation pour les ventes immobilières et le code de commerce pour les cessions de fonds, pour éviter que l’acquéreur ne s’engage sans financement.
5. Exemple de clause suspensive de prêt
Voici un exemple simplifié :
« La présente promesse de vente est consentie et acceptée sous la condition suspensive que l’acquéreur obtienne, avant le [date], un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant de [X euros] sur une durée de 7 années, au taux maximal de [Z %]. À défaut de présentation d’une offre ou en cas de refus de prêt justifié, la présente promesse de vente sera réputée caduque, sans que l’acquéreur ait à verser d’indemnité ni subir de pénalité. »
6. Différence entre condition suspensive et condition résolutoire
Il ne faut pas confondre la condition suspensive de prêt et la condition résolutoire.
- La condition suspensive empêche la conclusion de la vente tant que l’événement futur n’est pas réalisé.
- La condition résolutoire annule rétroactivement la vente si un événement survient après la signature.
Dans la pratique, la première est la plus utilisée lors d’un achat de fonds de commerce, notamment pour sécuriser l’acquéreur.
7. Jurisprudence et encadrement légal
La cour de cassation rappelle régulièrement que la condition suspensive de prêt doit être rédigée de manière claire et complète. À défaut, elle peut être écartée par un tribunal, sans que le contrat de vente ne soit frappé de nullité ou considéré comme irrégulier.
Depuis la loi Scrivener et l’évolution du droit de la consommation, toute promesse synallagmatique de vente ou acte authentique doit inclure une clause suspensive dès lors que l’acquéreur a recours à un emprunt.
8. Les pièges à éviter
Plusieurs erreurs peuvent fragiliser la sécurité juridique de l’opération :
- Ne pas préciser les caractéristiques du prêt (montant, taux, durée).
- Fixer un délai trop court, rendant impossible l’obtention de prêt.
- Négliger de demander une preuve écrite du refus de prêt.
- Rédiger une clause trop vague, laissant place à l’interprétation.
Pour éviter ces écueils, il est conseillé de recourir à un avocat en droit commercial qui saura adapter la condition suspensive à chaque transaction.
9. Le rôle du notaire et de l’avocat
Le notaire assure la sécurisation juridique de l’acte de cession et veille au respect des conditions suspensives. L’avocat conseille son client (acheteur ou vendeur) dans la rédaction de la clause et dans la négociation des modalités prévues au contrat.
Le plus souvent, le notaire est en charge de la vente des murs et l’avocat assure la cession de l’entreprise.
Ils travaillent ensemble pour garantir la validité de l’opération et protéger les intérêts des parties.
10. Conclusion
La condition suspensive de prêt est un mécanisme indispensable pour protéger l’acquéreur d’un fonds de commerce qui a besoin d’un financement bancaire. Bien rédigée, elle permet d’annuler la vente sans conséquence si l’obtention du prêt est impossible.
Cependant, une rédaction maladroite peut fragiliser l’acte de vente et générer des litiges. Le recours à un avocat spécialisé et à un notaire est donc vivement recommandé pour sécuriser l’achat et éviter les pièges à éviter.
En pratique, il convient de toujours vérifier la conformité de la clause aux exigences du code de la consommation, du code civil et du code de commerce, afin d’assurer la protection de l’acheteur et la sécurité des parties.
Vous souhaitez céder ou acheter un fonds de commerce ?
📞 01 30 30 23 06 | 📧 cabinet@martin.avocat.fr
🗓️ Cabinets à Ermont et Pontoise – du lundi au vendredi
📍 Rendez-vous possible en visio ou en présentiel – Intervention dans toute la France
FAQ – Condition suspensive de prêt dans la cession de fonds de commerce
1. La condition suspensive de prêt s’applique-t-elle aussi en matière de crédit immobilier ?
Oui. Par analogie avec l’achat d’un logement financé par un emprunt, la cession d’un fonds de commerce peut inclure une condition suspensive liée à l’acceptation d’un crédit immobilier ou bancaire. Tant que la réalisation de la condition n’est pas acquise (accord formel de la banque), la promesse unilatérale de vente ou le compromis de vente ne produit pas ses effets définitifs.
2. Que devient la promesse unilatérale de vente si le financement est refusé ?
En cas de refus de la banque, la vente est réputée caduque : l’acquéreur n’a pas à signer l’acte définitif et peut récupérer son dépôt de garantie si cette conséquence a été stipulée dans le contrat. Le cédant ne peut exiger d’indemnité sauf en cas de faute ou d’absence de démarches sérieuses de financement.
3. La condition suspensive concerne-t-elle uniquement la chose vendue ?
Non. La condition suspensive de prêt n’affecte pas la nature de la chose vendue (le fonds de commerce), mais la possibilité d’acquisition. Elle est directement liée au financement de l’entreprise reprise et aux modalités prévues par les termes du contrat.
4. Comment la clause protège-t-elle l’acheteur ?
L’objectif est la protection de l’acheteur. Si le prêt n’est pas accordé, il peut se libérer de son obligation d’achat sans encourir de sanction. Cette sécurité juridique est renforcée par le code de la consommation et le code de commerce, qui imposent une formulation claire et un délai déterminé pour obtenir l’approbation des autorités bancaires.
5. Que se passe-t-il si un droit de préemption s’exerce ?
Le droit de préemption (par exemple de la commune ou du bailleur en bail commercial) est un événement futur qui peut empêcher la cession. Il fonctionne de manière parallèle à la condition suspensive : si le droit est exercé, la vente au candidat initial ne peut être réalisée.
6. Qu’en est-il du dépôt de garantie ou indemnité d’immobilisation ?
Le dépôt de garantie versé lors de la signature du compromis ou de la promesse synallagmatique est destiné à sécuriser la transaction. Si la réalisation de la condition échoue pour cause de refus de prêt, ce montant doit être restitué à l’acquéreur, sauf stipulation contraire. Attention, une clause mal rédigée peut exposer à des litiges.
7. Quels sont les exemples concrets de mise en œuvre ?
- Exemple 1 : un professionnel souhaite acheter une entreprise artisanale. Le compromis de vente précise qu’il doit obtenir un prêt d’un montant déterminé sous 45 jours. En cas de défaut de financement, la vente est annulée sans pénalité.
- Exemple 2 : un cédant de fonds en bail commercial insère une clause prévoyant qu’en cas de refus du crédit immobilier, la promesse unilatérale de vente deviendra caduque.
- Exemple 3 : dans un projet de reprise, la clause suspensive mentionne le nombre d’établissements bancaires à solliciter. L’absence de dossier ou de justificatif pourrait être considérée comme une faute de l’acheteur.
8. Quels sont les critères d’une bonne rédaction ?
Pour éviter les litiges, il faut prévoir dans la clause :
- Le montant de l’emprunt ;
- Le taux maximal accepté ;
- La durée de remboursement ;
- Le délai déterminé pour l’approbation bancaire ;
- Les conséquences de la non-réalisation de la condition.
Ces éléments sont essentiels pour garantir la sécurité juridique et éviter les solutions contraires aux intérêts des parties.